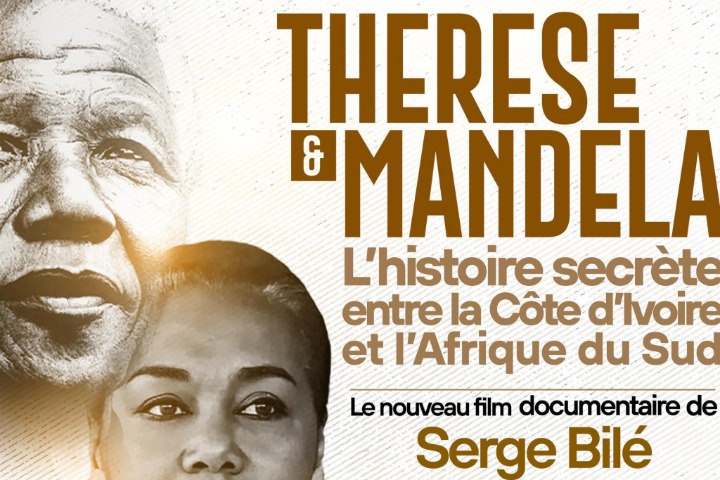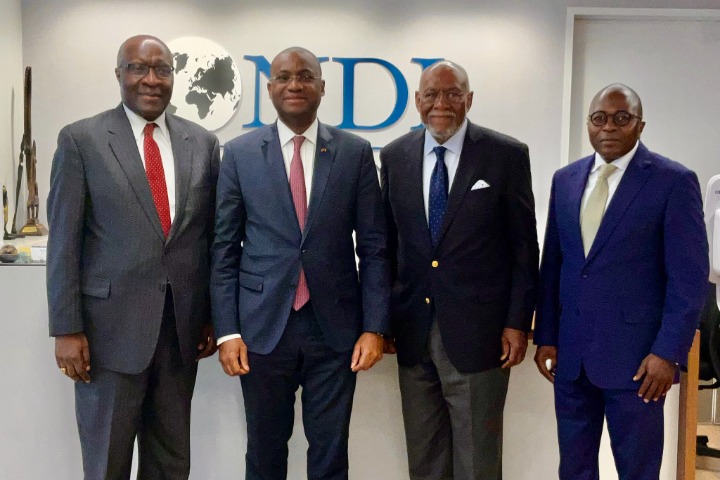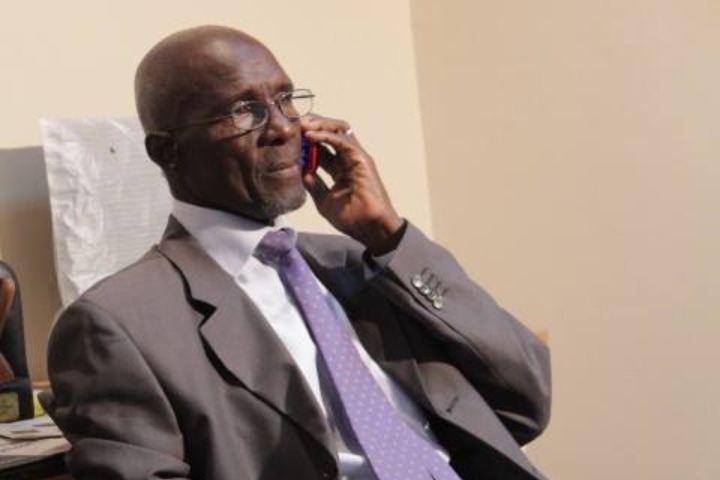Défendant sa forfaiture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, Chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani NASSIRE a affirmé lors de son passage à l’émission Mali Kura Taasira 3 que le Mali est dans l’ordre constitutionnel après l’adoption de la constitution de juillet 2023 par référendum.
Par cette déclaration, l’administrateur civil s’accroche à une définition simpliste du retour à l’ordre constitutionnel qui n’honore pas son rang de ministre.
Invité de l’émission Mali Kura Taasira 3, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani NASSIRE, a étalé sa méconnaissance des principes fondamentaux du droit constitutionnel à travers une affirmation tendancieuse. Celui qui est chargé des réformes politiques, sans hésitation, clame et exhibe que notre pays est déjà dans l’ordre constitutionnel, étonnamment du seul fait de l’adoption, en juillet 2023, d’une nouvelle constitution par référendum.
« On nous a imposé des terminologies qui n’ont rien à voir avec la réalité. Vous ne pouvez pas parler de transition à un pouvoir qui a déjà adopté une Constitution en vigueur, là où trois présidents élus ont échoué. Le simple fait d’avoir une Constitution signifie que nous sommes dans l’ordre constitutionnel », a-t-il affirmé pour défendre le régime en place face aux critiques de violation de la loi fondamentale. Pour se conforter dans sa thèse, l’administrateur oppose cette adoption, représentée comme une prouesse, aux différents régimes dits, selon lui, démocratiques n’ayant pas été en mesure de la réaliser.
C’est évidemment un bon point pour les autorités de la transition d’avoir reçu là où trois présidents démocratiquement élus, selon lui, ont échoué à concrétiser.
Cependant, il fait une confusion lamentable entre l’existence d’une constitution et le retour effectif à l’ordre constitutionnel.
Il convient de rappeler que l’adoption d’une Constitution par un pouvoir d’exception, en l’occurrence la transition en cours, ne saurait, à elle seule, consacrer le retour à l’ordre constitutionnel.
Cet ordre suppose non seulement un texte fondamental, mais surtout la mise en œuvre effective des institutions prévues par ce texte. En effet, un président élu au suffrage universel, un Parlement légitime issu des élections, une Cour constitutionnelle indépendante et fonctionnelle, le respect scrupuleux des libertés publiques, entre autres.
En clair, le retour à l’ordre constitutionnel est un paquet de principes, de valeurs et de droits.
Or, depuis le renversement du régime de feu Ibrahim Boubacar KEÏTA en août 2020, une bonne partie de ce paquet est transgressée. La mise en place des trois organes de la transition est une illustration palpable.
La mise à jour d’aucun des organes de la transition n’a été faite conformément à la nouvelle constitution.
À ce jour, ils sont tous en conflit avec des textes du pays, à commencer par la présidence assurée par le général Assimi GOÏTA, chef d’État autoproclamé au terme d’un double coup d’État.
Ce pouvoir est fondé sur la base d’une légitimité jugée populaire, non par le suffrage librement exprimé par les Maliens. Sa prestation de serment devant la Cour suprême ne saurait lui conférer la légalité d’une élection démocratique conformément aux principes constitutionnels.
Idem pour le Conseil national de Transition (CNT) qui n’est pas non plus l’émanation d’élections libres comme l’exige la loi fondamentale (article 96 de la nouvelle constitution : les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député.
Les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte.) Cet organe qui fait office de Parlement a été constitué sur la base d’appels à candidatures au sein des « forces vives » du pays. Ses membres ont ensuite été désignés par décret présidentiel. D’où le refus de la Cour constitutionnelle de les accorder le statut de députés.
Au-delà des institutions, l’ordre constitutionnel garantit avant tout les libertés et droits fondamentaux. Or, malgré l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale en juillet 2023, des décrets présidentiels continuent de restreindre des libertés essentielles, telles que celle de réunion des partis politiques.
Comment alors prétendre que le Mali est revenu dans l’ordre constitutionnel, alors même que le régime en place s’arroge des pouvoirs qu’aucune Constitution démocratique ne saurait lui conférer durablement ?
Si le retour à l’ordre constitutionnel ne saurait se résumer aux élections, l’adoption d’une constitution est aussi loin de consacrer le retour à l’ordre constitutionnel.
Certes, l’adoption d’une nouvelle constitution représente une étape importante dans le processus de retour à la normalité institutionnelle. Mais elle ne saurait suffire à elle seule.
En effet, adopter une constitution est une condition nécessaire, mais nullement suffisante. Ce n’est qu’un point de départ vers un retour véritable à l’ordre constitutionnel, qui exige plus que des mots : des actes, des institutions fonctionnelles et une gouvernance fondée sur le droit et non sur la force. Et l’application de la constitution, dont il se targue de l’adoption, n’est à ce jour pas effective.
SIKOU BAH