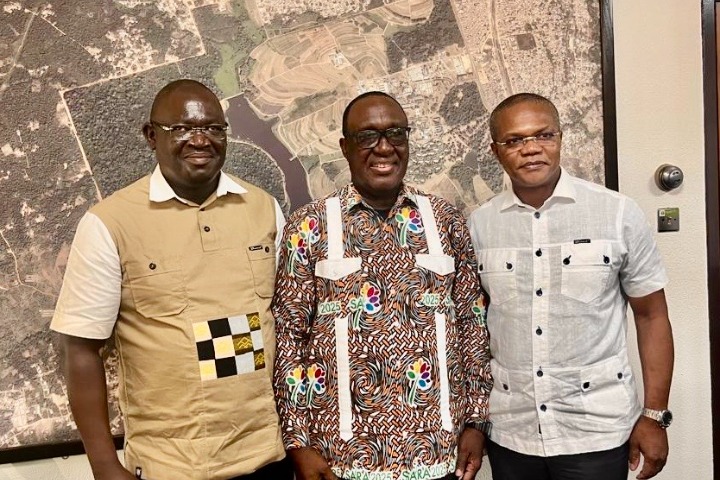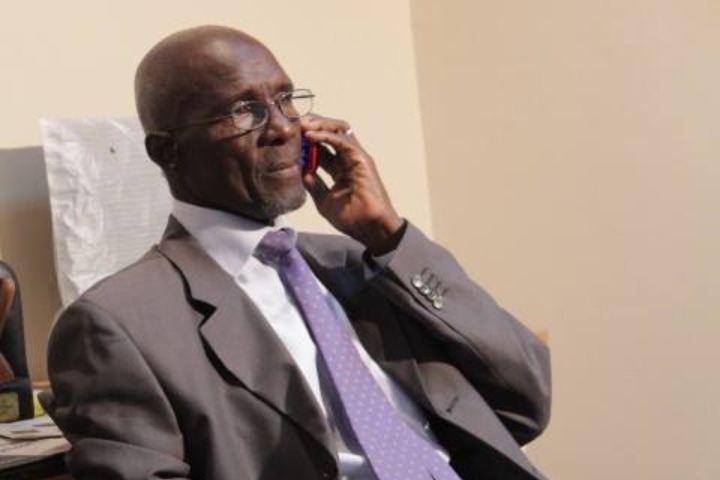Au milieu des bombardements incessants, des déplacements de la population et du manque de ressources, les enfants de la bande de Gaza sont parmi les individus les plus vulnérables du petit territoire face à la riposte israélienne déclenchée à la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Cette riposte contre les Palestiniens de Gaza met leur avenir en jeu, selon un expert interrogé par Le Devoir.
Dans la bande de Gaza, environ 40 % de la population a moins de 15 ans. Au total, on compte déjà plus de 3700 personnes tuées par les frappes israéliennes en 12 jours. Près de la moitié (1574) des personnes tuées seraient des enfants, selon les autorités palestiniennes.
Entre 2000 et 2022, d’après des données de l’ONG israélienne B’Tselem — qui milite pour les droits des Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés —, plus de 2200 mineurs auraient perdu la vie sous les balles et les bombardements de l’armée israélienne. Le bilan risque de s’alourdir de manière importante cette année.
La guerre affecte les enfants sur les plans psychologique, physique et social, explique au Devoir Olivier Arvisais, professeur au Département de didactique de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Outre les blessures physiques et les traumatismes psychologiques qui peuvent émerger chez l’enfant, « il y a tous les aspects liés à l’insécurité qui peuvent affecter le développement émotionnel et cognitif des enfants ».
Une situation particulière à Gaza
Les enfants de la bande de Gaza font face à une situation particulière en raison des cycles de violence fréquents qui perdurent, notamment depuis le blocus imposé par Israël sur le territoire depuis 2007, mais pas que. « Ça fait [plus de] 70 ans que les Palestiniens, en général, sont impliqués dans un conflit avec Israël. Une des particularités qui touchent vraiment les enfants palestiniens, et les enfants gazaouis en particulier, c’est le traumatisme intergénérationnel », rappelle M. Arvisais, rejoint en Suisse.
Le traumatisme vécu par les parents ou les grands-parents palestiniens plus tôt dans leur vie se répercute chez leurs enfants et aura un impact sur les générations futures. À Gaza, cependant, « le cycle est tellement rapide, maintenant, que ça dépasse un peu cette idée de traumatisme intergénérationnel. Les enfants vont déjà être traumatisés plusieurs fois dans leur vie et même dans les années cruciales de leur développement », entre les âges de 0 à 10 ans, souligne le chercheur.
On remarque aussi que les cas de trouble du stress post-traumatique (TSPT), nombreux parmi les enfants du territoire, se démarquent de ceux relevés dans d’autres zones de conflit. « Chez les enfants à Gaza, [le TSPT] atteint souvent des niveaux de complexité qu’on ne voit pas beaucoup ailleurs. […] C’est une particularité aussi des conflits où il y a une intensité et une récurrence fréquentes. »
Une étude menée au sein de 1029 jeunes de 11 à 17 ans à Gaza par des chercheurs britanniques, publiée en 2020 dans la revue Front Psychiatry, dénote que la majorité des enfants questionnés ont vécu eux-mêmes une forme de traumatisme psychologique (88,4 %), ont assisté à une forme de traumatisme sur une autre personne (83,7 %) ou ont assisté à la destruction de résidences et d’infrastructures (88,3 %). Un peu plus de la moitié des enfants (53,5 %) présentaient un diagnostic de TSPT, et ces diagnostics étaient plus nombreux chez les enfants ayant subi les trois formes de chocs traumatiques étudiées.
Les conséquences de tels traumatismes sont multiples, soulève Olivier Arvisais. À long terme, ces enfants peuvent tomber plus facilement dans des situations d’exploitation et d’abus (comme le travail des enfants ou le recrutement par des groupes armés), voir leur situation de vulnérabilité et de pauvreté s’aggraver, mais surtout, ils peuvent développer des mécanismes d’adaptation qui, au fil du temps, auront des effets délétères sur leur développement.
« Ça peut engendrer une désensibilisation émotionnelle à long terme à la violence, note le professeur. Ça peut amener les enfants à développer des comportements à risque en grandissant, comme la consommation de drogues ou la violence. » L’insécurité constante vécue par les enfants gazaouis mène aussi à une forme d’hypervigilance, ajoute le professeur.
La résilience par l’apprentissage
La situation actuelle dans la bande de Gaza, soumise à un siège d’Israël et où l’aide humanitaire vient tout juste d’être autorisée à entrer après plus d’une semaine, aura des conséquences irréversibles sur la population mineure. « Si, demain matin, le conflit actuel s’arrête, ça va prendre des années, voire des décennies à Gaza pour se relever de son état de destruction », observe M. Arvisais.
Il travaille présentement sur un projet de recherche portant sur le développement cognitif et les capacités d’apprentissage des enfants palestiniens en milieu scolaire à Gaza, en collaboration avec l’UQAM, le Conseil de recherches en sciences humaines et sociales du Canada ainsi que le Gaza Community Mental Health Programme, une ONG locale palestinienne.
« Le but, c’est de produire des connaissances qui vont aider les enseignants, les psychologues et les travailleurs sociaux à mieux travailler avec les enfants qui vivent dans ces conditions », décrit Olivier Arvisais. Ces connaissances permettraient aux acteurs sur le terrain de travailler en priorisant la résilience et le bien-être des enfants, afin de préserver leur capacité à apprendre, et à « atténuer les effets négatifs sur leur développement cognitif que la violence et la guerre ont sur eux ».
Selon lui, la capacité d’apprendre est une compétence clé au développement des enfants. « C’est probablement une des plus grandes ressources dont dispose l’être humain. Si elle est affectée, on réduit les chances d’un enfant d’être capable de répondre à ses propres besoins, d’assouvir ses rêves, ses ambitions, de se développer, de contribuer au développement d’une société positive. »
Si les futures générations de zones en conflit, comme à Gaza, ont une capacité d’apprentissage réduite en raison de problèmes de développement, c’est sans espoir, d’après M. Arvisais. « La solution pour les Palestiniens, ce sont les futures générations. Si on ne cherche pas de stratégies pour atténuer les effets du conflit, il n’y aura jamais cette future génération qui va pouvoir contribuer à la paix. »
Sarah Boumedda