Donald Harris et Shyamala Gopalan, nés dans d’ex-colonies britanniques de part et d’autre de la planète, choisirent d'étudier à Berkeley, aux Etats-Unis. Le cercle d’intellectuels qu’ils y trouvèrent détermina leur avenir.
À l’automne 1962, dans un bâtiment à l’écart du campus de l’Université de Californie à Berkeley, un doctorant jamaïcain grand et svelte s’adressait à un petit auditoire réuni pour l’occasion. Il dressait des parallèles entre son pays d’origine et les États-Unis.
À ce groupe d’étudiants Noirs, il expliquait qu’en grandissant en Jamaïque, il avait pu observer de près la puissance coloniale britannique et la manière dont un petit nombre de Blancs promouvait une “une élite Noire autochtone” pour masquer les inégalités sociales extrêmes qui règnaient sur l’île.
Donald J. Harris, à 24 ans, était réservé, à l’image de l’enfant de choeur anglican qu’il fut jadis, et son ton de voix était déjà professoral. Mais ses idées étaient subversives, au point de convaincre une membre de l’auditoire de venir lui parler à l’issue de son intervention.
Il s’agissait d’une scientifique indienne minuscule, vêtue d’un sari et de sandales, la seule autre étudiante étrangère à être venue assister à cette conférence qui portait sur les questions raciales aux États-Unis. Elle avait, se souvient-il, “une allure qui la distinguait immanquablement de tous les autres hommes ou femmes dans le groupe”.
Shyamala Gopalan était née la même année que M. Harris dans une colonie britannique située de l’autre côté de la planète. Sa vision du système colonialiste était celle de la fille d’un haut fonctionnaire, plus privilégiée, lui expliqua-t-elle. Sa présentation l’avait frappée et elle était désireuse d’en savoir plus.
“Tout cela m’ intéressait beaucoup et, pour être franc, ne manquait pas de charme”, confie M. Harris, âgé aujourd’hui de 82 ans et professeur émérite d’économie à Stanford, dans des réponses écrites aux questions du New York Times. “Lors d’un rendez-vous ultérieur, nous nous sommes à nouveau parlé, puis à celui d’après. Le reste appartient à l’histoire”.
.La Sénatrice Kamala Harris décrit volontiers les circonstances de la rencontre de ses parents: deux étudiants étrangers idéalistes, emportés dans la mouvance pour les droits civiques aux États-Unis, une variante de la trajectoire classique de l’immigration américaine.
Mais ce résumé peine à restituer l’expérience unique qu’offrait Berkeley au début des années 1960. La communauté au sein de laquelle ils rencontrèrent était un creuset de radicalité politique où la gauche syndicale se frottait aux premiers intellectuels nationalistes Noirs.
Cette effervescence offrait l’occasion à une vague d’étudiants Noirs en licence, dont de nombreux descendants de métayers ou d’esclaves venus du Texas et de la Louisiane, de rencontrer et de dialoguer avec des homologues étrangers venus de pays qui avaient rejeté la domination coloniale.
Certains membres du groupe d’études où M. Harris et Mme Gopalan firent connaissance en 1962, appelé l’Afro American Association, contribueraient à fonder la discipline universitaire des études Noires, à introduire la fête de Kwanza et à fonder le Black Panther Party.
La communauté engendrée à Berkeley survécut longtemps après que l’intensité de ce début de la décennie 1960 ne s’apaise.
La Sénatrice Harris, qui n’a pas souhaité intervenir dans cet article, fut parmi les candidats les plus modérés à l’investiture du parti démocrate pour l’élection présidentielle de 2020. Elle exprime sa vision politique en termes résolument pragmatiques.
“Je n’essaie pas de restructurer la société”, disait-elle l’été dernier. “J’essaie simplement de résoudre les problèmes qui réveillent les gens en pleine nuit”.
Pourtant, à certains moments très médiatisés — notamment lorsqu’elle a accepté la nomination à la vice-présidence — elle a souligné l’influence durable qu’a eue sur elle l’entourage de ses parents à Berkeley. Pour Shyamala Gopalan et Donald Harris, ces amitiés-là bouleverseraient tout.
“Je devais y aller”
Les étudiants les plus méritants de colonies britanniques comme la Jamaïque et l’Inde étaient, depuis toujours et par automatisme, envoyés au Royaume-Uni pour leurs études supérieures. Mais Donald Harris et Shyamala Gopalan étaient différents. Chacun pour ses propres raisons impérieuses
Dans le cas de Mme Gopalan, le problème tenait au fait qu’elle était une femme.
L’aînée d’une brillante famille tamoule brahmane, elle voulait être biochimiste. Mais au Lady Irwin College, une université fondée par les Britanniques qui dispensait une formation scientifique aux Indiennes, elle avait été forcée de préparer un diplôme en sciences domestiques. Cela faisait beaucoup rire son frère et son père.
“Mon père et moi, on n’arrêtait pas de la taquiner”, se rappelle Gopalan Balachandran, son frère, qui deviendrait par la suite docteur en informatique et en économie. “On lui disait: ‘qu’est-ce que vous étudiez en sciences domestiques? On vous apprend à mettre le couvert pour le dîner?’’’. Elle se fâchait et elle riait. Elle nous disait : ‘Vous ne savez pas ce que j’étudie’”.
Sa soeur est décédée en 2009. Rétrospectivement, son frère se rend compte combien elle devait enrager.
“Elle devait se sentir terriblement frustrée”, reconnaît-il aujourd’hui.
Mais elle avait un plan d’action: contrairement à l’Inde ou au Royaume-Uni, il était encore possible d’envoyer un dossier d’admission pour un cursus de biochimie aux États-Unis, dit son frère. Reçue à l’Université de Californie à Berkeley, elle mit son père devant le fait accompli.
Son père en fut stupéfait mais ne s’opposa pas à son projet, raconte son frère. “Il était simplement inquiet : aucun de nous n’avait jamais été à l’étranger. Il disait ‘je ne connais personne aux États-Unis et certainement personne à Berkeley.’ Elle lui répondait ‘ne t’inquiète pas, papa’”. Il a offert de lui payer sa première année d’études.
À 13 000 kilomètres de là, en 1961, M. Harris vivait une situation similaire, cette fois pour entamer un doctorat en sciences économiques.
Avec la prestigieuse bourse d’études qui lui avait accordée, l’autorité coloniale britannique s’attendait à ce qu’il parte en Angleterre, comme l’avaient fait tous les précédents récipiendaires.
Mais M. Harris ne voulait pas aller en Angleterre. Il avait baigné dans la culture britannique sa scolarité entière, au rythme des couplets bien dociles de “Rule, Britannia”. (“Lisez les paroles, vous serez stupéfait!”, dit-il). Il avait commencé à entrevoir, se rappelle-t-il, comment “la raideur du faste, de la cérémonie et de la classe” au Royaume-Uni essaimait jusque dans les plantations jamaïcaines.
Non, lui, ce sont les États-Unis qui l’attiraient.
Adolescent, il écoutait les big bands de jazz diffusés depuis la base navale américaine de Guantánamo. Un soir il était même tombé sur une émission de fin de soirée consacrée au rythm and blues sur la station WLAC, qui émettait depuis Nashville. Pour lui, les États-Unis — “vus de loin et sans doute y avait-il une part de naïveté en moi” — lui semblaient être “la dynamique vivante et évolutive d’une société racialement et ethniquement complexe”.
Il avait découvert l’université de Berkeley à l’occasion d’un reportage sur des étudiants qui partaient dans le Sud y militer en faveur des droits civiques.
“Une recherche plus approfondie sur de cette université m’a convaincu que c’était là que devais m’inscrire,” dit-il.
Utiliser la bourse qu’il avait obtenue pour étudier aux États-Unis constituait “une telle rupture avec les usages en vigueur”, explique-t-il, que le secrétaire permanent du Ministère de l’Éducation écrivit à un éminent professeur antillais, Sir Arthur Lewis, qui enseignait l’économie à l’Université de Manchester. Les délibérations mirent si longtemps que les cours avaient déjà débuté lorsque la réponse de l’économiste, tomba, favorable.
“J’étais fou de joie”, se souvient M. Harris. Deux semaines après le début du semestre, il prit l’avion pour San Francisco. La chronique d’une rencontre venait d’être enclenchée.
Trouver sa place dans un groupe
Très vite, Shyamala Gopalan s’est noué des amitiés durables à Berkeley.
À l’automne 1959, dans la queue qu’elle faisait pour l’inscription aux cours, il y avait derrière elle un adolescent Noir venu d’Oakland, Cedric Robinson.
En 1960, Berkeley comptait moins de 100 Noirs sur 20 000 étudiants, indique l’historienne Donna Murch dans son livre “Living for the City : Migration, Education and the Rise of the Black Panther Party”.
M. Robinson, dont le grand-père avait fui l’Alabama dans les années 1920 pour échapper à un lynchage, était le premier de sa famille à s’inscrire à Berkeley. “En tant qu’enfant Noir d’Oakland, il ne savait même pas ce qu’il fallait faire pour entrer à l’université”, se souvient sa veuve, Elizabeth.
La femme devant lui l’impressionnait. Mme Gopalan, son aînée de deux ans, portait souvent un sari à cette époque, et les personnes qu’elle connaissait se rappellent qu’elle semblait issue d’une famille royale; elle en avait la prestance. Quand ce fut au tour de M. Robinson de s’approcher du bureau pour s’inscrire, le responsable administratif le prit pour un étudiant africain et demanda poliment si son pays allait aussi régler ses frais de scolarité.
M. Robinson, décédé en 2016, trouvait hilarante cette confusion, dit l’historien Robin D.G. Kelley, et c’est une anecdote qu’il évoquerait souvent par la suite. Il obtendrait une maîtrise puis un doctorat avant de se voir confier un poste permanent à l’Université de Californie à Santa Barbara et d’écrire cinq livres en cours de route. Mme Gopalan et lui resteraient de proches amis toute leur vie.
Dans “Black Marxism : The Making of the Black Radical Tradition”, son ouvrage le plus connu, publié en 1983, M. Robinson mentionne les amis de longue date qui l’avaient aidé à formuler sa pensée. Tous étaient Noirs, sauf Mme Gopalan.
Tous deux rejoignirent un cercle d’intellectuels Noirs qui se réunissaient chez Mary Agnes Lewis, une étudiante en anthropologie qui vivait hors du campus. Baptisé ultérieurement ‘Afro American Association’, ce groupe fut “l’institution qui compta le plus dans la formation du mouvement Black Power”, explique Mme Murch, qui y consacre deux chapitres de son livre.
Ce n’était pas un club de lecture décontracté: chacun avait des ouvrages à lire et on était sanctionné si on n’était pas à jour. Pour une discussion sur l’existentialisme, un étudiant venu d’un ‘community college’, un établissement public pré-universitaire, s’était vu fustiger pour ne pas avoir lu l’ouvrage qu’on lui avait attribué, se souvient Margot Dashiell, qui a aujourd’hui 78 ans et devint professeure de sociologie à l’université de Laney, en Californie. L’etudiant s’appelait Huey Newton et serait co-fondateur du Black Panther Party.
“À la réunion suivante, il est arrivé parfaitement préparé”, s’amuse Mme Dashielle.
C’est lors de ces réunions spartiates — “le plus souvent, on était assis par terre”, raconte-t-elle — qu’elle fut exposée pour la première fois à l’idée que la culture noire américaine trouvait ses racines en Afrique. “Nous apprenions une langue nouvelle”, dit-elle. “Nous inventions un langage nouveau. Le premier mot nouveau était ‘afro-américain’. C’était la première fois de ma vie que je l’entendais. Nous n’allions pas être cette chose sans origine, Nègre. Nous allions clamer notre patrimoine haut et fort.”
Mme Dashiell explique qu’ils avaient tous été élevés dans l’idée qu’ils devaient se penser “intégrationnistes” et se battre pour être admis dans les institutions blanches. “Là, c’était une bouleversement révolutionnaire de la pensée” qui affirmait que “nous sommes différents, mais que les différences ne sont pas mauvaises”.
Plus tard, le groupe restreindrait les adhésions aux personnes d’ascendance africaine, refusant même les partenaires blancs de membres Noirs, précise Mme Murch.
Parce qu’elle avoir grandi dans une ancienne colonie, et que c’était une personne de couleur, il ne faisait aucun doute que Shyamala Gopalan y avait sa place, s’accordent à dire d’anciens membres du groupe interviewés pour cet article.
“Elle avait entièrement sa place parmi les frères et les soeurs. Il n’y a jamais eu de problème à ce sujet”, dit Aubrey LaBrie, qui enseignera par la suite la question du nationalisme Noir à l’Université d’État de San Francisco. “Elle était tout simplement acceptée comme membre du groupe.”
En tant que telle, Mme Gopalan plaisantait parfois à propos du monde si différent qu’elle avait quitté. Mme Dashiell se souvient qu’elle riait en racontant à M. Robinson qu’un prétendant avait contacté sa famille en vue d’un mariage arrangé, et qu’une ruée sur les prévisions astrologiques s’en était suivie.
De plus en plus d’étudiants étrangers s’enrôlaient à Berkeley, venus de nations nouvellement indépendantes qui formaient leurs propres élites, non blanches. Les groupes se trouvaient naturellement des affinités.
“Voilà des gens qui arrivaient d’ailleurs avec une vision plus large de ce qu’était le monde, et c’était des personnes de couleur”, explique l’historienne Nell I. Painter, qui a maintenant 78 ans et dont le père travaillait à Berkeley à l’époque. “Je me souviens que ces gens d’ailleurs incarnaient une forme de liberté intellectuelle”.
En rejoignant le campus en 1962, M. Harris a immédiatement intégré le groupe d’études.
Quelques jours à peine après son arrivée, il croisa un étudiant en architecture noir qui manifestait tout seul, brandissant une pancarte peinte à la main contre l’apartheid en Afrique du Sud. Il alla faire sa connaissance. C’était Kenneth Simmons, un des “phares” de l’Afro American Association aux côtés de Mme Lewis et M. Robinson, décrit M. Harris.
Pour M. Harris, le groupe d’études était une oasis intellectuelle qui l’a fait toucher “aux réalités de la condition afro-américaine dans sa forme la plus authentique et la plus brute, dans toute sa richesse et sa complexité, sa fortune et sa pauvreté, ses espoirs et ses désespoirs”.
C’est là qu’à l’automne 1962 il rencontra sa future épouse. “Nous nous sommes parlé ce jour-là, reparlé à la réunion d’après, puis à celle d’après, et celle d’après”, se souvient-il. L’année suivante, ils étaient mariés.
Mme Gopalan avait toujours compté retourner en Inde après ses études.“Je n’étais pas venue pour rester”, a-t-elle expliqué à un journaliste du SF Weekly. “C’est l’histoire classique : je suis tombée amoureuse d’un type, on s’est marié, et assez vite les enfants sont arrivés. »Politique d’action réelle
Avec leurs accents distingués et la confiance intellectuelle qui émanait d’eux, le couple formé par Don Harris et Shyamala Gopalan Harris était à part, disent celles et ceux qui les ont connus à l’époque. Anne Williams, aujourd’hui âgée de 76 ans, qui était encore adolescente lorsqu’elle les a rencontrés, décrit M. Harris comme “réservé et d’un abord professoral”, un homme qu’il n’était pas facile de mieux connître. Mme Gopalan était au contraire “chaleureuse” et “charmante”.
“On voyait tout de suite qu’elle était ‘pour le peuple’, entre guillemets, même si elle avait des airs d’aristocrate”, dit-elle. “C’était une femme, et de peau très brune, mais elle aurait pu facilement glisser d’un groupe à l’autre du point de vue racial”.
Baron Meghnad Desai, 80 ans, un économiste d’origine indienne, se souvient avoir croisé le couple sur les marches d’une maison où ils se rendaient tous dîner. À l’époque, “nos discussions étaient très animées. On pouvait se quereller à propos des situations politiques d’un tas de pays”.
Mme Gopalan Harris était une oratrice passionnée, “impétueuse et radicale mais absolument pas marxiste”. Son mari, se souvient-il, “s’intéressait de près à l’économie politique radicale, mais c’était un contradicteur calme et patient. »
“Il n’y avait aucun doute, ils étaient extrêmement proches, très amoureux”, assure M. Desai.
L’époque présidait à l’effondrement généralisé des puissances coloniales. L’année 1960 vit 17 pays africains accéder à l’indépendance. La même année, Fidel Castro était reçu à bras ouverts à Harlem et y rencontrait Malcolm X, le dirigeant de l’Union soviétique Nikita Khrouchtchev et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru.
“Nous étions convaincus qu’un grand champ de possibilités s’ouvrait à nous”, dit M. Desai. “Les pouvoirs chutaient et étaient remplacés par des gouvernements de gauche. C’était vraiment un bouleversement total. »
Aux yeux de beaucoup dans ce cercle d’amis, il y avait un lien entre la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et les mouvements d’indépendance en cours dans d’autres pays, note M. LaBrie, un membre du groupe qui devint un ami durable de la famille.
“Il y avait une continuité évidente entre les droits civiques et les soutiens de la révolution cubaine”, entre le leader indépendantiste congolais Patrice Lumumba et la révolution algérienne, analyse M. LaBrie. “Les choses étaient interconnectées, personne ne se donnait d’étiquette.”
En 1963 et 1964, cinq membres du groupe d’études partirent pour Cuba dans le cadre d’un voyage organisé par le Comité d’Étudiants pour les Voyages à Cuba — en violation d’une interdiction du Département d’État américain — pour s’informer sur les conditions de vie des Afro-Cubains sous le gouvernement de Fidel Castro. Mme Williams et un autre membre du groupe, James L. Lacy, se souviennent d’avoir entendu parler de ce voyage pour la première fois lors d’une réunion organisée par le couple Harris.
“Ceux de nous qui s’affichaient nationalistes encourageaient les peuples de Cuba, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale à poursuivre leur action”, explique M. Lacy, un professeur à la retraite aujourd’hui âgé de 85 ans.
M. Harris assure qu’il ne se rappelle pas avoir milité sur la question cubaine, et que cela aurait compromis leur statut d’immigrants. “Nous étions certainement très au fait des règles et lois encadrant notre rôle en tant qu’étudiants étrangers, et nous les respections scrupuleusement”, écrit-il.
Les manifestations pour les droit civiques, elles, occupaient beaucoup le couple. Dans son discours le mois dernier à la Convention nationale démocrate, la sénatrice Harris a dit que ses parents étaient “tombés amoureux de la manière la plus américaine qui soit, en manifestant côte à côte pour la justice pendant le mouvement des droits civiques des années 1960”.
Pour les étudiants étrangers — dont beaucoup venaient de pays où les organisations étudiantes de gauche étaient bien établies — la montée en puissance de l’activisme leur donnait le sentiment d’être à leur place, explique l’économiste indien Amartya Sen, 86 ans, qui enseignait à Berkeley à l’époque et s’était lié d’amitié avec le couple Harris.
“Tout d’un coup, l’Amérique semblait un pays moins étranger”, analyse M. Sen, prix Nobel d’économie en 1998. “Désormais ils se faisaient beaucoup d’amis et ils prenaient racine”.
“Ces liens sont devenus un village"
À la naissance de Kamala, le premier enfant du couple, en 1964, les forces politiques aux États-Unis étaient à nouveau en pleine mutation.
Les étudiants blancs avaient sauté à pieds joints dans le mouvement protestataire, rejetant l’establishment et les mœurs anachroniques des années 1950. Le soutien aux luttes d’émancipation du tiers-monde cédait progressivement la place aux revendications du droit politique à la liberté d’expression. En 1966, surgi semble-t-il de nulle part, l’acteur Ronald Reagan réussissait à mobiliser un électorat conservateur assoupi et évinçait le gouverneur démocrate de Californie.
Le mariage des Harris a commencé à battre de l’aile quand M. Harris se mit à accepter des vacations de courte durée dans deux universités de l’Illinois. Lorsqu’il fut sélectionné par l’Université du Wisconsin pour un poste ouvrant à titularisation, Gopalan Harris choisit, elle, de s’installer avec ses enfants à Oakland et à West Berkeley.
Pour leur fille de cinq ans, la rupture était claire.
“Je savais qu’ils s’aimaient beaucoup, mais ils étaient devenus comme l’eau et l’huile”, écrit la Sénatrice Harris dans ‘The truths we hold’ — ‘Les vérités que nous tenons’ — ses mémoires publiés en 2018. Elle estime que “s’ils avaient été un peu plus âgés, un peu plus mûr émotionnellement, peut-être leur mariage aurait-il pu survivre. Mais ils étaient si jeunes. Mon père était le premier amoureux de ma mère”.
La carrière de M. Harris prendrait son envol. Critique de gauche de la théorie économique néoclassique, c’était un professeur apprécié qui devint le premier chercheur Noir nommé au département de sciences économiques de l’université Stanford. Mais un froid glacial s’était glissé entre lui et sa femme.
Mme Gopalan Harris, devenue chercheuse et auteure de travaux influents sur le rôle des hormones dans le cancer du sein, demanda le divorce en 1972. La séparation la meurtrit tellement que, des années durant, elle coupa presque tout contact avec M. Harris. Quand elle invita ses parents à la remise de son diplôme d’études secondaires, Kamala Harris raconte qu’elle craignait que sa mère ne vienne pas.
“La séparation l’avait rendue assez malheureuse mais elle s’y était déjà habituée et ne voulait plus l’évoquer avec Don”, pense son frère, M. Balachandran. “Quand vous aimez quelqu’un puis que l’amour se mue en amertume très profonde, vous ne voulez même pas lui adresser la parole.”
M. Harris se dit toujours insatisfait des conditions convenues pour la garde de leurs filles, qui ont mis un “coup d’arrêt brutal” à ses contacts étroits avec elles. Pendant la campagne électorale, Kamala Harris a peu évoqué son père, lequel a refusé les demandes précédentes d’entretien avec The New York Times : “la recherche de célébrité, ce n’est pas mon truc et je fais des efforts considérables pour m’en préserver”.
“Il n’a pas été présent après le divorce”, a déclaré Meena Harris, la nièce de la sénatrice Harris, au New Yorker. “Leur expérience de femmes Noires a été façonnée par leurs vies au sein de ces communautés de Berkeley et d’Oakland, et non à travers le prisme de leurs origines caraïbéennes”.
Ce vide fut comblé par de vieux amis de Mme Gopalan Harris qu’elle s’était faits au sein du groupe d’études de Berkeley. Elle était célibataire, mère de deux enfants et loin de sa famille. Ce n’est que lorsque sa fille aînée entra au lycée qu’elle put verser l’acompte nécessaire pour s’acheter sa propre maison, ce qu’elle voulait à tout prix, relate Kamala Harris dans ses mémoires.
Le réseau de solidarité qui les soutenait — la garde des enfants, l’église, les parrains et marraines, les leçons de piano — émanait de l’Afro American Association.
“Ces liens sont devenus le ‘village’ qui l’a aidée à élever ses enfants”, résume Mme Dashiell, la professeure de sociologie qui avait fait partie du groupez. “Je ne veux pas dire d’un point de vue financier. Ils ont veillé sur ces enfants”.
Aubrey LaBrie présenta Mme Gopalan Harris à sa tante Regina Shelton, qui avait une garderie à West Berkeley. Née en Louisiane, cette dernière devint un pilier dans la vie de la jeune famille, leur louant même un appartement situé au-dessus de la garderie.
Mme Gopalan Harris travaillait souvent tard, se souvient Carole Porter, 56 ans, une amie d’enfance de la sénatrice Harris, et avait beaucoup d’ambition pour ses filles.
“Shyamala n’était pas du genre à jouer”, dit-elle. “Quand vous êtes immigrée, que vous mesurez un mètre cinquante et que vous parlez avec un accent — quand il vous arrive ce genre de choses, ça vous endurcit”.
Mais il y avait toujours à manger et de l’affection à glaner chez Mme Shelton. S’il était trop tard, les filles restaient dormir chez elle, ou Mme Shelton envoyait les siennes les mettre au lit chez elles. Dans l’une des anecdotes d’enfance favorites de la sénatrice Harris, elle raconte qu’elle avait préparé des carrés au citron avec du sel à la place du sucre. Mme Shelton, la grimace aux lèvres, avait fait mine de les trouver délicieux.
Le dimanche matin, Mme Shelton emmenait les filles à la Church of God de la 23ème Avenue, une église baptiste Noire. C’est, assure Mme Porter, ce que Shyamala souhaitait pour elles.
“Elle les a élevées comme des femmes Noires », affirme-t-elle. “Shyamala voulait vraiment qu’elles aient les deux”.
Mme Dashiell est persuadée que l’influence du groupe d’études a survécu dans une certaine mesure chez les enfants Harris.
“La réflexion engagée au sein de l’association était profonde”, explique-t-elle. “On se demandait: quelles étaient les causes sous-jacentes aux problèmes auxquels nous faisons face, nous les Noirs? Et c’est quelque chose qui s’est transmis à Kamala, au travers de ces familles”.
Kamala Harris a souvent dit par la suite que la communauté d’élection de sa mère immigrée — des familles Noires qui n’étaient qu’à une génération du Sud ségrégué — avait profondément façonné la politicienne qu’elle est devenue. Lorsqu’elle a prêté serment pour devenir procureure générale de Californie, puis sénatrice des États-Unis, elle a demandé à placer sa main sur la Bible de Mme Shelton.“Que ce soit au bureau ou au combat”, écrit-elle dans un essai paru l’an dernier, “Mme Shelton est toujours présente en moi”.
Ellen Barry























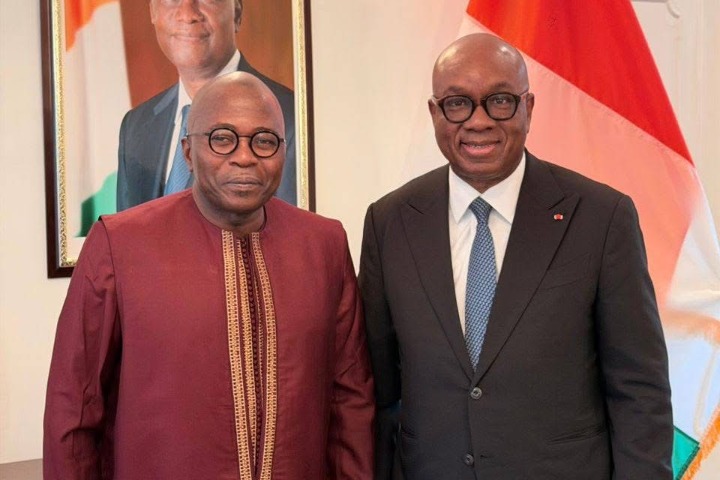



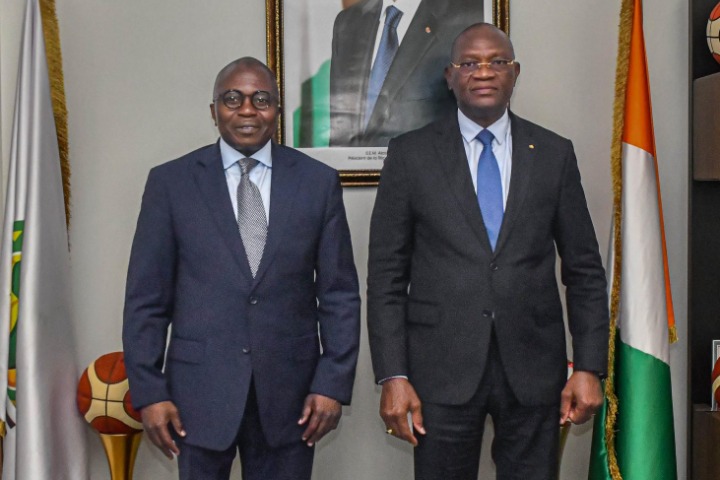

















Publié le :
10 novembre 2020Par:
Solange Aouti loba